Ces interviews ont été réalisées dans le cadre de la réflexion conduite par la DPSA sur la place et le rôle de la société civile dans l’élaboration des politiques publiques et sur la perception de ces entrepreneurs d’un certain « modèle lyonnais ».Vétérinaires sans frontières (VSF) est née à Lyon en 1983 sous l'impulsion de jeunes rhônalpins, vétérinaires comme Bruno Rebelle, ou humanitaires comme Denys Aguettant, à partir d'un constat simple : l'élevage joue un rôle économique et social primordial dans les pays en voie de développement et pourtant, très peu d'ONG interviennent dans ce secteur.A travers ces deux interviews, ces co fondateurs de VSF, partis chacun vers des horizons bien différents depuis plusieurs années, reviennent sur l’histoire de VSF et nous livrent leurs différentes perceptions de Lyon et de ses caractéristiques.INTERVIEW DE BRUNO REBELLEmilitant de l’humanitaire et de l’écologie, un des fondateur puis directeur de l’association VSF - Vétérinaires sans frontières devenue depuis AVSF - Agronomes et Vétérinaires sans frontières.Propos recueillis le 30 octobre 2009 par Catherine Panassier.
Qu’est-ce qui vous a personnellement conduit à vous engager dans la création de VSF ?
A la fin de mes études vétérinaires, je suis parti en Amérique Latine pendant trois mois où j’ai rencontré des petits paysans et des petits éleveurs. Je me disais qu’il y avait des médecins, des agronomes, mais pas de vétérinaires qui venaient en aide aux éleveurs. De retour en France, j’ai retrouvé une amie de promotion qui revenait de Thaïlande et qui faisait le même constat. Nous nous sommes dit : « Pourquoi pas ? ». C’est à ce moment que Denys Aguettant directeur du Comité Européen d’Aide aux Réfugiés qui gérait des camps de réfugiés en Somalie, m’a contacté. Le Comité cherchait de l’expertise vétérinaire pour monter des ateliers d’élevage, notamment des poulaillers, dans les camps de réfugiés. Nous nous sommes retrouvés Denys, son frère Guillaume, d’autres collègues vétérinaires et moi même autour de la table de ma cuisine et nous avons décidé de nous lancer. C’était au mois de novembre 1983. Nous avons choisi de nous appeler VSF car à l’époque MSF, Médecins Sans Frontière, était en plein rayonnement.
Est-ce que le fait que votre partenaire, Denys Aguettant, soit de la famille des laboratoires Aguettant a facilité votre décision de créer VSF ?
Non, les laboratoires Aguettant n’ont jamais été liés à VSF. Ils étaient surtout concentrés sur les sérums humains et n’avaient pas vraiment de connexion avec le monde vétérinaire. De plus, nous n’étions pas du tout dans une logique de favoriser la vente des produits de laboratoires tout lyonnais qu’ils soient. Mais, Denys Aguettant avait une bonne connaissance du milieu lyonnais et surtout de la Région Rhône Alpes. Nous avons donc bâti une alliance objective. Lui apportait son réseau lié à l’aide humanitaire et j’apportais, avec mes collègues vétérinaires, l’ancrage dans le milieu professionnel. Après quelques années au cours desquelles Denys Aguettant a été délégué général de l’association, il a opté pour d’autres perspectives professionnelles.
Qui vous a aidé dans votre démarche de création de VSF ?
A l’évidence, Charles Mérieux est celui qui nous a le plus aidé. C’était un grand humaniste, un homme fantastique, un vrai entrepreneur social.
D’abord il nous a aidé pour que VSF soit créée à Lyon. Au départ, j’ai fait le tour des quatre écoles vétérinaires de France en commençant bien sûr par celle de Lyon où j’avais fait mes études. Mais, seul Michel Fontaine, professeur à l’école de Lyon, plutôt engagé, a adhéré à notre démarche. Les écoles de Nantes et de Toulouse n’ont pas voulu considérer notre projet, et le professeur Pilet, alors directeur de l’école de Maisons-Alfort a voulu nous prendre l’idée pour créer VSF à Paris. Dans cet objectif, elle a même convoqué rapidement une assemblée générale pour entériner cette création. Charles Mérieux est intervenu. Les connexions lyonnaises ont joué. Le fait qu’il soit très attaché à sa ville et à l’idée de faire vivre un pôle « humanitaire » à Lyon a pesé pour que le contre projet parisien n’existe pas. Et lorsque le professeur Pilet a convoqué plus discrètement une nouvelle assemblée générale, c’est nous qui nous sommes opposés en nous y rendant et en affirmant l’antériorité de notre existence.
Quand nous avons démarré notre activité, je suis allé voir Charles Mérieux pour lui décrire plus précisément notre projet, lui dire que nous avions beaucoup d’idées et lui dire aussi que nous avions besoin d’aide. Il a alors fait un chèque de 15000 francs pour nous permettre de faire nos premiers pas.
Des années plus tard, quand nous avions une forte activité et d’énormes problèmes de trésorerie, il nous a à nouveau aidé en nous faisant un prêt de cinq millions de francs sur son compte personnel.
En fait, pourquoi avez-vous créé l’association à Lyon et non à Annecy, votre ville d’origine, ou à Paris ?
Tout simplement parce qu’après mon bac, je suis venu faire ma préparation véto au lycée du Parc à Lyon, puis l’école vétérinaire de Lyon à Marcy L'Etoile. A la fin de mes études, j’ai travaillé à Lyon, créé VSF puis je suis parti monter mon propre cabinet dans le Vercors parce que c’était le monde rural qui m’intéressait. Non seulement je préférais les vaches aux caniches, mais en plus on me proposait de travailler avec l’association pour la promotion de l’agriculture dans le parc naturel du Vercors et c’était tout à fait passionnant. Je pouvais là aussi allier mon métier à une forme de militantisme. Je faisais donc des allers retours entre Lyon, où se développait VSF, et le Vercors où j’habitais et travaillais. Au bout de trois ans, mon cabinet marchait bien, mais VSF aussi avait pris de l’ampleur et je n’arrivais plus à concilier les deux. Aussi, lorsque mon collègue Jan François Cautin, militant de VSF, m’a proposé de venir travailler avec lui à Lyon dans le service d’urgence vétérinaire qu’il avait monté, j’ai accepté bien volontiers. Nous avons travaillé ensemble jusqu’en 1990, date à laquelle j’ai pris le poste de directeur de VSF que j’ai occupé pendant six ans.
C’est vrai que nous nous étions posé la question de savoir s’il était préférable de créer VSF à Lyon ou à Paris. Deux facteurs nous ont poussé à choisir Lyon. Le premier, c’est le TGV. Nous pouvions facilement aller à Paris et donc rester à Lyon sans être déconnectés des réseaux parisiens. Le deuxième était le fait de bénéficier à Lyon d’un véritable espace, où nous étions soutenus, et où nous pouvions nous faire connaître et rayonner plus facilement. Si l’on avait créé VSF à Paris, nous n’aurions pas eu le même écho. Nous aurions été noyés dans une multitude d’initiatives et notre démarche aurait été plus difficilement lisible.
Vous sentez-vous lyonnais aujourd’hui ?
J’aime Lyon, c’est une ville qui est devenue très belle, avec une vie culturelle intéressante. Mais j’habite Montreuil et son éclectisme me va bien. Je n’ai jamais été vraiment connecté avec le réseau lyonnais. On est lyonnais ou on ne l’est pas, mais on a du mal à le devenir…
LYON, L' HUMANISTE
De votre point de vue, Lyon est-elle une ville humaniste, ouverte sur le monde ?
Lyon est une ville où effectivement il y a une tradition humaniste. Cependant, j’ai du mal à voir comment cela se traduit aujourd’hui en actes concrets, en politiques sociales ou culturelles spécifiques. Il est certain que Lyon a un profil sociologique particulier, celui d’une ville bourgeoise qui n’exprime pas fondamentalement un besoin de rayonner. Il faut peut être y voir une marque de son passé marqué par l’importance des « soyeux » : « faisons notre commerce de soie et laissons nos affaires prospérer tranquillement ! ». Aujourd’hui, il y a un décalage profond entre des ambitions de rayonnement affichées et l’identité profonde de la ville. Lyon n’est pas une ville qui aime se mettre en avant. Elle progresse prudemment. Il ne faut pas brusquer les choses, les gens, les habitudes, les façons de faire. C’est le changement dans la continuité.
A votre avis, la ville ou l’agglomération lyonnaise se distinguent-elles par un certain « esprit de conciliation » qui faciliterait la prise de décision sur certains sujets d’intérêt général ?
Si un certain « esprit de conciliation » règne sur Lyon, c’est parce que, avant tout, il y a une volonté de ne pas afficher de conflits. Alors, on est contraint de s’arranger. Le moteur principal de ces relations est l’évitement du conflit. C’est probablement lié à l’histoire de cette bourgeoisie lyonnaise riche, influente et très attachée à la paix sociale pour ne pas devoir être remise en question. Et puis, il y a l’effet provincial : tout se sait, nous sommes entre nous, nous nous protégeons les uns les autres. Enfin, on ne peut nier l’influence de la franc-maçonnerie qui pèse sur les relations et impose une forme de régulation tranquille.
LE MONDE ASSOCIATIF LYONNAIS
Comment caractériseriez-vous le milieu associatif et son influence dans la création de votre association ?
Au moment de la création de VSF, au début des années 1980, nous nous sommes très vite connectés avec deux réseaux : celui de la santé, avec Handicap International et Jean–Baptiste Richardier, et celui du développement avec la faculté catholique, la DCC (Délégation Catholique pour la Coopération) et plus particulièrement le Ciedel avec Gilbert Graugnard et Bernard Husson. Nous étions très bien accueillis : monter une association humanitaire à Lyon était une idée très bien vue et facilement soutenue. Nous étions dans l’héritage de Pauline Jaricot, dans la vocation « humaniste » de Lyon. Mais surtout HI (Handicap International) avait déjà marqué le terrain et les esprits. Il y avait un vrai terreau propice à la création de telles activités. J’ai pu le vérifier quand, devant des problèmes très concrets de locaux, HI et notre association avons décidé de créer l’ERAC, l’Espace Rhône-Alpes de Coopération. Notre idée était de regrouper les acteurs de l’humanitaire dans une dynamique et dans un espace communs. Michel Noir nous a soutenu dans ce projet et nous a mis des locaux adéquats à disposition. Outre HI et VSF, il y avait le Comité pour Léré, Architectes et ingénieurs du Monde et pas très loin l’OIP. Nous avons créé ainsi un effet de masse. Par ailleurs, Bioforce, là encore avec Charles Mérieux, était en pleine phase de développement. Effectivement, à cette époque, Lyon bénéficiait d’un milieu associatif particulièrement actif et entreprenant dans le domaine de l’humanitaire.
Dans les années 1980, de nombreux mouvements ou associations se sont créés à l’exemple d’Handicap International, de Bioforce, de la Marche pour l’égalité, d’Habitat et Humanisme ou de l’OIP. Ces associations ou mouvements, comme d’autres à l’exemple de la Cimade de l’ALPIL ou de Forum réfugiés, étaient portés par de fortes personnalités comme Jean Costil, André Gachet, Christian Delorme, Jean–Baptiste Richardier, Charles Mérieux, Olivier Brachet, Jean-Pierre Aldeguer ou encore le prêtre Bernard Devert. Pour exister à Lyon, une association se doit-elle d’être portée par une personnalité et que deviennent ces associations après le départ des fondateurs ?
L’effet provincial favorise probablement la personnalisation. On existe plus facilement à Lyon, mais on reste dans un microcosme où tout le monde se connait. Je ne sais pas bien ce que deviendront des associations comme Handicap International quand les fondateurs, et tout particulièrement quand Jean–Baptiste Richardier s’en ira. En ce qui concerne VSF, je suis parti en 1996 et l’association a perduré. Elle a fusionné avec une autre association pour devenir AVSF (Agronomes et Vétérinaires sans frontières) et elle a continué ses activités. Elle a poursuivi sa route peut être sans prendre le tournant que j’aurais souhaiter personnellement. En 1996, VSF travaillait bien, c’était une association reconnue pour la qualité de ses apports techniques. Pour ma part, après six années en tant que directeur, j’étais arrivé au bout d’un cycle. Je souhaitais aller plus loin, intégrer plus de « politique » dans nos actions, pour interférer par exemple sur les politiques d’aide au développement. Ainsi, à partir des années 1990, la banque mondiale a lancé de grands mouvements pour démanteler les services publics vétérinaires dans les PVD.
C’était une nouvelle étape de la mise en place des politiques d’ajustement structurel. Nous avons réagi et alerté les autorités en France et dans les pays concernés : croire que les vétérinaires privés pourraient remplacer les services publics était une erreur. Nous étions plutôt partisans d’organiser les éleveurs pour qu’ils gèrent la demande de service. Mais, cette idée était considérée comme une affreuse idée de gauche, une idée inconcevable pour les pouvoirs en place.
Cette démarche vers le politique m’a aussi poussé à monter un contre sommet au moment du G7 à Lyon, contre sommet que nous avons baptisé « J’ai 7 questions à vous poser !» où nous avons réuni de grandes personnalités.
A ce moment le Président de VSF n’était pas sur ce même objectif, ne voulait pas d’une telle évolution. Il était ravi d’avoir comme directeur un vétérinaire, mais moins heureux d’avoir un « Rebelle » !
Je ne souhaitais pas jouer au co-fondateur qui s’accroche, je suis parti.
Ces associations et tout particulièrement VSF ont-elles, d’une manière ou d’une autre, influencé les politiques publiques ?
Nous n’avons pas vraiment su influencer les politiques publiques. Nous n’avons eu que peu d’impact sur les orientations de la coopération décentralisée. A l’époque ce type de démarche n’était pas porté par la ville, ni par la communauté urbaine, mais seulement par la Région. Nous avions donc surtout des relations avec les élus régionaux. Or, avec Charles Béraudier, Charles Million, ou encore Xavier Hamelin, nous ne partagions pas tout à fait la même conception de l’aide développement et de l’action humanitaire. Ils étaient encore dans une logique « néocolonialiste ». De notre côté, nous n’étions pas des professionnels du lobbying et surtout nous n’étions pas assez politiques.
Nous avons été plus influents à Paris, au Ministère de la coopération. A Paris, « les Lyonnais », c’est à dire principalement notre équipe et celle d’Handicap International, nous avions un réel pouvoir de proposition et d’orientation. Nous avons ainsi permis, par exemple, l’avènement des contrats pluriannuels de coopération (entre le ministère et les ONGs), ou encore la création du fonds d’étude et d’évaluation pour accroître la qualité des interventions des associations.
L'HUMANITAIRE AUJOURD'HUI
Pensez-vous que ce terreau propice à la création, à l’installation et au développement d’ONG, notamment dans le domaine de l’humanitaire, existe encore à Lyon ?
J’ai l’impression que ces dynamiques sont moins fortes aujourd’hui. Plus généralement le militantisme s’est déplacé, désertant l’humanitaire pour se focaliser sur la solidarité envers les personnes sans domicile fixe, les sans voix… puis se tourner vers l’altermondialisme, notamment avec des mouvements comme ATTAC. A nouveau, on dirait que ces mouvements s’étiolent. Aujourd’hui, l’écologie draine beaucoup plus de monde que la solidarité internationale.
Lyon est-elle encore une plateforme particulière et reconnue dans le domaine de l’humanitaire ?
Lyon est effectivement marquée par ce trait de caractère. Cependant, c’est vraiment dommage que la ville n’en n’ai pas fait une force, un symbole. Le potentiel était fantastique, avec Bioforce, Handicap International, la faculté catholique, VSF. Au début avec l’ERAC, et forts de cette densité d’associations humanitaires, nous voulions conforter une dynamique, créer une université permanente, un DESS humanitaire… Aujourd’hui, l’ERAC, ce n’est qu’un ensemble de locaux qui abrite des associations qui travaillent dans le même domaine.
Je crois que dans le domaine l’humanitaire à Lyon, nous avons raté la connexion avec le monde de la recherche et de la formation et les collectivités locales. Nous n’avons pas su construire ce trio ONG – Universités - Collectivités qui aurait permis un partage et un portage collectif de cette thématique, de cette « spécificité lyonnaise ». Nous n’avons pas su profiter de l’opportunité de bâtir un véritable pôle de santé publique humanitaire dans le sillage de Charles Mérieux. Pour gagner en attractivité, pour essaimer, il faut que la dynamique dépasse l’objet de chaque association, de chaque acteur. C’est en maillant les acteurs que l’on devient plus intelligent, mais nous n’avons pas su construire ce maillage. Nous étions jeunes et un peu insouciants, en tout cas pas suffisamment prospectifs. Vingt ans après, je mesure tout ce qu’il aurait été intéressant de bâtir et qui ne l’a pas été.
Aujourd’hui, l’humanitaire à Lyon, c’est surtout un discours non ancré.
AVSF est toujours localisée à Lyon, mais son centre de gravité l’est-il aussi ?
AVSF rayonne peu et je pense qu’être localisée à Lyon n’est plus une plus-value.
N’est-ce pas des associations comme Don Quichotte, Ni Putes Ni Soumises ou encore Greenpeace qui ont moins d’ancrage locale qui, aujourd’hui, prennent le relais de l’expression et de la mobilisation
militantes ?
Des Jean-Baptiste Richardier, qui fondent une ONG, la développent d’une façon extraordinaire, la font rayonner et qui, trente ans plus tard sont toujours là, ça n’existe plus !
Et puis les formes d’engagements ont évolué. Le public militant zappe plus facilement d’une cause à une autre. L’action humanitaire est probablement moins « fun » que la confrontation à la Greenpeace. Cet engagement est aujourd’hui plus global, plus déconnecté des territoires. Les mobilisations on line, les grands mouvements internationaux, les réseaux connectés font que l’ancrage local, le creuset d’où part l’action est beaucoup moins important.
A la fin de mes études vétérinaires, je suis parti en Amérique Latine pendant trois mois où j’ai rencontré des petits paysans et des petits éleveurs. Je me disais qu’il y avait des médecins, des agronomes, mais pas de vétérinaires qui venaient en aide aux éleveurs. De retour en France, j’ai retrouvé une amie de promotion qui revenait de Thaïlande et qui faisait le même constat. Nous nous sommes dit : « Pourquoi pas ? ». C’est à ce moment que Denys Aguettant directeur du Comité Européen d’Aide aux Réfugiés qui gérait des camps de réfugiés en Somalie, m’a contacté. Le Comité cherchait de l’expertise vétérinaire pour monter des ateliers d’élevage, notamment des poulaillers, dans les camps de réfugiés. Nous nous sommes retrouvés Denys, son frère Guillaume, d’autres collègues vétérinaires et moi même autour de la table de ma cuisine et nous avons décidé de nous lancer. C’était au mois de novembre 1983. Nous avons choisi de nous appeler VSF car à l’époque MSF, Médecins Sans Frontière, était en plein rayonnement.
Est-ce que le fait que votre partenaire, Denys Aguettant, soit de la famille des laboratoires Aguettant a facilité votre décision de créer VSF ?
Non, les laboratoires Aguettant n’ont jamais été liés à VSF. Ils étaient surtout concentrés sur les sérums humains et n’avaient pas vraiment de connexion avec le monde vétérinaire. De plus, nous n’étions pas du tout dans une logique de favoriser la vente des produits de laboratoires tout lyonnais qu’ils soient. Mais, Denys Aguettant avait une bonne connaissance du milieu lyonnais et surtout de la Région Rhône Alpes. Nous avons donc bâti une alliance objective. Lui apportait son réseau lié à l’aide humanitaire et j’apportais, avec mes collègues vétérinaires, l’ancrage dans le milieu professionnel. Après quelques années au cours desquelles Denys Aguettant a été délégué général de l’association, il a opté pour d’autres perspectives professionnelles.
Qui vous a aidé dans votre démarche de création de VSF ?
A l’évidence, Charles Mérieux est celui qui nous a le plus aidé. C’était un grand humaniste, un homme fantastique, un vrai entrepreneur social.
D’abord il nous a aidé pour que VSF soit créée à Lyon. Au départ, j’ai fait le tour des quatre écoles vétérinaires de France en commençant bien sûr par celle de Lyon où j’avais fait mes études. Mais, seul Michel Fontaine, professeur à l’école de Lyon, plutôt engagé, a adhéré à notre démarche. Les écoles de Nantes et de Toulouse n’ont pas voulu considérer notre projet, et le professeur Pilet, alors directeur de l’école de Maisons-Alfort a voulu nous prendre l’idée pour créer VSF à Paris. Dans cet objectif, elle a même convoqué rapidement une assemblée générale pour entériner cette création. Charles Mérieux est intervenu. Les connexions lyonnaises ont joué. Le fait qu’il soit très attaché à sa ville et à l’idée de faire vivre un pôle « humanitaire » à Lyon a pesé pour que le contre projet parisien n’existe pas. Et lorsque le professeur Pilet a convoqué plus discrètement une nouvelle assemblée générale, c’est nous qui nous sommes opposés en nous y rendant et en affirmant l’antériorité de notre existence.
Quand nous avons démarré notre activité, je suis allé voir Charles Mérieux pour lui décrire plus précisément notre projet, lui dire que nous avions beaucoup d’idées et lui dire aussi que nous avions besoin d’aide. Il a alors fait un chèque de 15000 francs pour nous permettre de faire nos premiers pas.
Des années plus tard, quand nous avions une forte activité et d’énormes problèmes de trésorerie, il nous a à nouveau aidé en nous faisant un prêt de cinq millions de francs sur son compte personnel.
En fait, pourquoi avez-vous créé l’association à Lyon et non à Annecy, votre ville d’origine, ou à Paris ?
Tout simplement parce qu’après mon bac, je suis venu faire ma préparation véto au lycée du Parc à Lyon, puis l’école vétérinaire de Lyon à Marcy L'Etoile. A la fin de mes études, j’ai travaillé à Lyon, créé VSF puis je suis parti monter mon propre cabinet dans le Vercors parce que c’était le monde rural qui m’intéressait. Non seulement je préférais les vaches aux caniches, mais en plus on me proposait de travailler avec l’association pour la promotion de l’agriculture dans le parc naturel du Vercors et c’était tout à fait passionnant. Je pouvais là aussi allier mon métier à une forme de militantisme. Je faisais donc des allers retours entre Lyon, où se développait VSF, et le Vercors où j’habitais et travaillais. Au bout de trois ans, mon cabinet marchait bien, mais VSF aussi avait pris de l’ampleur et je n’arrivais plus à concilier les deux. Aussi, lorsque mon collègue Jan François Cautin, militant de VSF, m’a proposé de venir travailler avec lui à Lyon dans le service d’urgence vétérinaire qu’il avait monté, j’ai accepté bien volontiers. Nous avons travaillé ensemble jusqu’en 1990, date à laquelle j’ai pris le poste de directeur de VSF que j’ai occupé pendant six ans.
C’est vrai que nous nous étions posé la question de savoir s’il était préférable de créer VSF à Lyon ou à Paris. Deux facteurs nous ont poussé à choisir Lyon. Le premier, c’est le TGV. Nous pouvions facilement aller à Paris et donc rester à Lyon sans être déconnectés des réseaux parisiens. Le deuxième était le fait de bénéficier à Lyon d’un véritable espace, où nous étions soutenus, et où nous pouvions nous faire connaître et rayonner plus facilement. Si l’on avait créé VSF à Paris, nous n’aurions pas eu le même écho. Nous aurions été noyés dans une multitude d’initiatives et notre démarche aurait été plus difficilement lisible.
Vous sentez-vous lyonnais aujourd’hui ?
J’aime Lyon, c’est une ville qui est devenue très belle, avec une vie culturelle intéressante. Mais j’habite Montreuil et son éclectisme me va bien. Je n’ai jamais été vraiment connecté avec le réseau lyonnais. On est lyonnais ou on ne l’est pas, mais on a du mal à le devenir…
LYON, L' HUMANISTE
De votre point de vue, Lyon est-elle une ville humaniste, ouverte sur le monde ?
Lyon est une ville où effectivement il y a une tradition humaniste. Cependant, j’ai du mal à voir comment cela se traduit aujourd’hui en actes concrets, en politiques sociales ou culturelles spécifiques. Il est certain que Lyon a un profil sociologique particulier, celui d’une ville bourgeoise qui n’exprime pas fondamentalement un besoin de rayonner. Il faut peut être y voir une marque de son passé marqué par l’importance des « soyeux » : « faisons notre commerce de soie et laissons nos affaires prospérer tranquillement ! ». Aujourd’hui, il y a un décalage profond entre des ambitions de rayonnement affichées et l’identité profonde de la ville. Lyon n’est pas une ville qui aime se mettre en avant. Elle progresse prudemment. Il ne faut pas brusquer les choses, les gens, les habitudes, les façons de faire. C’est le changement dans la continuité.
A votre avis, la ville ou l’agglomération lyonnaise se distinguent-elles par un certain « esprit de conciliation » qui faciliterait la prise de décision sur certains sujets d’intérêt général ?
Si un certain « esprit de conciliation » règne sur Lyon, c’est parce que, avant tout, il y a une volonté de ne pas afficher de conflits. Alors, on est contraint de s’arranger. Le moteur principal de ces relations est l’évitement du conflit. C’est probablement lié à l’histoire de cette bourgeoisie lyonnaise riche, influente et très attachée à la paix sociale pour ne pas devoir être remise en question. Et puis, il y a l’effet provincial : tout se sait, nous sommes entre nous, nous nous protégeons les uns les autres. Enfin, on ne peut nier l’influence de la franc-maçonnerie qui pèse sur les relations et impose une forme de régulation tranquille.
LE MONDE ASSOCIATIF LYONNAIS
Comment caractériseriez-vous le milieu associatif et son influence dans la création de votre association ?
Au moment de la création de VSF, au début des années 1980, nous nous sommes très vite connectés avec deux réseaux : celui de la santé, avec Handicap International et Jean–Baptiste Richardier, et celui du développement avec la faculté catholique, la DCC (Délégation Catholique pour la Coopération) et plus particulièrement le Ciedel avec Gilbert Graugnard et Bernard Husson. Nous étions très bien accueillis : monter une association humanitaire à Lyon était une idée très bien vue et facilement soutenue. Nous étions dans l’héritage de Pauline Jaricot, dans la vocation « humaniste » de Lyon. Mais surtout HI (Handicap International) avait déjà marqué le terrain et les esprits. Il y avait un vrai terreau propice à la création de telles activités. J’ai pu le vérifier quand, devant des problèmes très concrets de locaux, HI et notre association avons décidé de créer l’ERAC, l’Espace Rhône-Alpes de Coopération. Notre idée était de regrouper les acteurs de l’humanitaire dans une dynamique et dans un espace communs. Michel Noir nous a soutenu dans ce projet et nous a mis des locaux adéquats à disposition. Outre HI et VSF, il y avait le Comité pour Léré, Architectes et ingénieurs du Monde et pas très loin l’OIP. Nous avons créé ainsi un effet de masse. Par ailleurs, Bioforce, là encore avec Charles Mérieux, était en pleine phase de développement. Effectivement, à cette époque, Lyon bénéficiait d’un milieu associatif particulièrement actif et entreprenant dans le domaine de l’humanitaire.
Dans les années 1980, de nombreux mouvements ou associations se sont créés à l’exemple d’Handicap International, de Bioforce, de la Marche pour l’égalité, d’Habitat et Humanisme ou de l’OIP. Ces associations ou mouvements, comme d’autres à l’exemple de la Cimade de l’ALPIL ou de Forum réfugiés, étaient portés par de fortes personnalités comme Jean Costil, André Gachet, Christian Delorme, Jean–Baptiste Richardier, Charles Mérieux, Olivier Brachet, Jean-Pierre Aldeguer ou encore le prêtre Bernard Devert. Pour exister à Lyon, une association se doit-elle d’être portée par une personnalité et que deviennent ces associations après le départ des fondateurs ?
L’effet provincial favorise probablement la personnalisation. On existe plus facilement à Lyon, mais on reste dans un microcosme où tout le monde se connait. Je ne sais pas bien ce que deviendront des associations comme Handicap International quand les fondateurs, et tout particulièrement quand Jean–Baptiste Richardier s’en ira. En ce qui concerne VSF, je suis parti en 1996 et l’association a perduré. Elle a fusionné avec une autre association pour devenir AVSF (Agronomes et Vétérinaires sans frontières) et elle a continué ses activités. Elle a poursuivi sa route peut être sans prendre le tournant que j’aurais souhaiter personnellement. En 1996, VSF travaillait bien, c’était une association reconnue pour la qualité de ses apports techniques. Pour ma part, après six années en tant que directeur, j’étais arrivé au bout d’un cycle. Je souhaitais aller plus loin, intégrer plus de « politique » dans nos actions, pour interférer par exemple sur les politiques d’aide au développement. Ainsi, à partir des années 1990, la banque mondiale a lancé de grands mouvements pour démanteler les services publics vétérinaires dans les PVD.
C’était une nouvelle étape de la mise en place des politiques d’ajustement structurel. Nous avons réagi et alerté les autorités en France et dans les pays concernés : croire que les vétérinaires privés pourraient remplacer les services publics était une erreur. Nous étions plutôt partisans d’organiser les éleveurs pour qu’ils gèrent la demande de service. Mais, cette idée était considérée comme une affreuse idée de gauche, une idée inconcevable pour les pouvoirs en place.
Cette démarche vers le politique m’a aussi poussé à monter un contre sommet au moment du G7 à Lyon, contre sommet que nous avons baptisé « J’ai 7 questions à vous poser !» où nous avons réuni de grandes personnalités.
A ce moment le Président de VSF n’était pas sur ce même objectif, ne voulait pas d’une telle évolution. Il était ravi d’avoir comme directeur un vétérinaire, mais moins heureux d’avoir un « Rebelle » !
Je ne souhaitais pas jouer au co-fondateur qui s’accroche, je suis parti.
Ces associations et tout particulièrement VSF ont-elles, d’une manière ou d’une autre, influencé les politiques publiques ?
Nous n’avons pas vraiment su influencer les politiques publiques. Nous n’avons eu que peu d’impact sur les orientations de la coopération décentralisée. A l’époque ce type de démarche n’était pas porté par la ville, ni par la communauté urbaine, mais seulement par la Région. Nous avions donc surtout des relations avec les élus régionaux. Or, avec Charles Béraudier, Charles Million, ou encore Xavier Hamelin, nous ne partagions pas tout à fait la même conception de l’aide développement et de l’action humanitaire. Ils étaient encore dans une logique « néocolonialiste ». De notre côté, nous n’étions pas des professionnels du lobbying et surtout nous n’étions pas assez politiques.
Nous avons été plus influents à Paris, au Ministère de la coopération. A Paris, « les Lyonnais », c’est à dire principalement notre équipe et celle d’Handicap International, nous avions un réel pouvoir de proposition et d’orientation. Nous avons ainsi permis, par exemple, l’avènement des contrats pluriannuels de coopération (entre le ministère et les ONGs), ou encore la création du fonds d’étude et d’évaluation pour accroître la qualité des interventions des associations.
L'HUMANITAIRE AUJOURD'HUI
Pensez-vous que ce terreau propice à la création, à l’installation et au développement d’ONG, notamment dans le domaine de l’humanitaire, existe encore à Lyon ?
J’ai l’impression que ces dynamiques sont moins fortes aujourd’hui. Plus généralement le militantisme s’est déplacé, désertant l’humanitaire pour se focaliser sur la solidarité envers les personnes sans domicile fixe, les sans voix… puis se tourner vers l’altermondialisme, notamment avec des mouvements comme ATTAC. A nouveau, on dirait que ces mouvements s’étiolent. Aujourd’hui, l’écologie draine beaucoup plus de monde que la solidarité internationale.
Lyon est-elle encore une plateforme particulière et reconnue dans le domaine de l’humanitaire ?
Lyon est effectivement marquée par ce trait de caractère. Cependant, c’est vraiment dommage que la ville n’en n’ai pas fait une force, un symbole. Le potentiel était fantastique, avec Bioforce, Handicap International, la faculté catholique, VSF. Au début avec l’ERAC, et forts de cette densité d’associations humanitaires, nous voulions conforter une dynamique, créer une université permanente, un DESS humanitaire… Aujourd’hui, l’ERAC, ce n’est qu’un ensemble de locaux qui abrite des associations qui travaillent dans le même domaine.
Je crois que dans le domaine l’humanitaire à Lyon, nous avons raté la connexion avec le monde de la recherche et de la formation et les collectivités locales. Nous n’avons pas su construire ce trio ONG – Universités - Collectivités qui aurait permis un partage et un portage collectif de cette thématique, de cette « spécificité lyonnaise ». Nous n’avons pas su profiter de l’opportunité de bâtir un véritable pôle de santé publique humanitaire dans le sillage de Charles Mérieux. Pour gagner en attractivité, pour essaimer, il faut que la dynamique dépasse l’objet de chaque association, de chaque acteur. C’est en maillant les acteurs que l’on devient plus intelligent, mais nous n’avons pas su construire ce maillage. Nous étions jeunes et un peu insouciants, en tout cas pas suffisamment prospectifs. Vingt ans après, je mesure tout ce qu’il aurait été intéressant de bâtir et qui ne l’a pas été.
Aujourd’hui, l’humanitaire à Lyon, c’est surtout un discours non ancré.
AVSF est toujours localisée à Lyon, mais son centre de gravité l’est-il aussi ?
AVSF rayonne peu et je pense qu’être localisée à Lyon n’est plus une plus-value.
N’est-ce pas des associations comme Don Quichotte, Ni Putes Ni Soumises ou encore Greenpeace qui ont moins d’ancrage locale qui, aujourd’hui, prennent le relais de l’expression et de la mobilisation
militantes ?
Des Jean-Baptiste Richardier, qui fondent une ONG, la développent d’une façon extraordinaire, la font rayonner et qui, trente ans plus tard sont toujours là, ça n’existe plus !
Et puis les formes d’engagements ont évolué. Le public militant zappe plus facilement d’une cause à une autre. L’action humanitaire est probablement moins « fun » que la confrontation à la Greenpeace. Cet engagement est aujourd’hui plus global, plus déconnecté des territoires. Les mobilisations on line, les grands mouvements internationaux, les réseaux connectés font que l’ancrage local, le creuset d’où part l’action est beaucoup moins important.
Bruno Rebelle |
|
 |
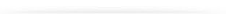 en France et à l'international  |
Catégories
Derniers billets
Nuage de tags
Agenda
Agriculture
Agro-alimentaire
Bio
Carbone
Climat
Collectivités
Danone
déchets nucléaire
Démocratie
Ecologie politique
Energie
ENR
Entreprises
Europe Ecologie
Fiscalité
G20
Grande Distribution
Grenelle
Inde
Jaitapur
Marcoule
Nucléaire
ONG
Politique
Principe de précaution
Répression
RSE
Social
Solaire
Derniers tweets
Archives
Le Blog de Bruno Rebelle © 2010











 Ma bio
Ma bio
Revue de presse
| Vendredi 30 Octobre 2009 à 15:17 | 0 commentaire